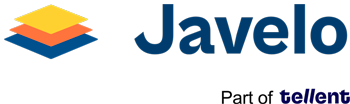Cloud public, privé ou hybride...
Cloud public, privé ou hybride : comment faire le bon choix ?

Cloud public, privé ou hybride : comment faire le bon choix ?
cloud, Amazon Web Services, AWS, Google Cloud
4/21/2025
Tags
- agenda,
- AI,
- actualité,
- Open AI,
- Open Source,
- devOps,
- cybersécurité,
- cloud,
- finOps,
- greenOps,
- secOps,
- Machine Learning,
- Conteneurs,
- Kubernetes,
- Amazon Web Services,
- AWS,
- Google Cloud,
- GCP,
- A1Cloud,
- reinvent2022,
- fosdem,
- monitoring,
- cicd,
- sre,
- devopsdays,
- Iot,
- Big Data,
- microservices,
- devSecOps,
- github,
- documentation,
- MySQL,
- migration
Cloud public, privé ou hybride : comment faire le bon choix ?
Face à la nécessité pour les entreprises de gérer des volumes croissants de données, la question du choix entre cloud public, privé ou hybride s’impose comme un enjeu stratégique.
Ce choix n’est pas anodin : il engage la sécurité des informations et les coûts, mais aussi des impératifs techniques liés aux bases de données, à la redondance des données et à la surveillance en temps réel.
Les entreprises doivent évaluer ces trois modèles en fonction de leurs exigences en matière de SLO (Service Level Objective), SLA (Service Level Agreement) et SLI (Service Level Indicator), des indicateurs essentiels garantissant la disponibilité et la fiabilité de leurs infrastructures.
À travers une analyse détaillée, cet article explore les différentes options, leurs implications et les critères à prendre en compte pour faire un choix éclairé.
Trois modèles, trois approches distinctes de l’architecture cloud
L’essor du cloud computing a profondément transformé la gestion des infrastructures informatiques. Les entreprises peuvent désormais externaliser leurs bases de données (MySQL, PostgreSQL), optimiser leurs capacités de stockage et sécuriser leurs données sans gérer directement des serveurs physiques.

Le cloud public repose sur une infrastructure mutualisée, gérée par des fournisseurs comme AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. Ces entreprises mettent à disposition des services informatiques accessibles en ligne, sur un modèle de facturation à l’usage.
Le cloud privé, à l’inverse, est une infrastructure dédiée à une seule organisation. Il peut être hébergé dans les propres datacenters de l’entreprise ou géré par un prestataire externe. Ce modèle offre un contrôle optimisé sur les ressources et la sécurité, mais nécessite un investissement plus conséquent en matériel et en maintenance.
Le cloud hybride combine ces deux approches : certaines ressources sont stockées sur un cloud privé, tandis que d’autres, plus flexibles ou moins sensibles, sont déployées sur un cloud public. Cette architecture permet d’adapter l’infrastructure aux contraintes spécifiques de chaque entreprise.
Le choix entre ces trois architectures repose sur plusieurs critères : surveillance en temps réel des performances, conformité aux exigences de SLA, reprise d’activité en cas d’incident et stratégie de sauvegarde des données.
L’innovation au service de la performance avec un contrôle réduit
Le principal argument en faveur du cloud public réside dans sa capacité à évoluer rapidement en fonction des besoins. L’accès immédiat à des ressources informatiques illimitées permet aux entreprises de s’adapter à des pics de charge sans nécessiter d’investissement préalable dans des infrastructures physiques.

Un modèle économique accessible
L’un des atouts du cloud public est son modèle économique basé sur la consommation réelle. Les entreprises paient uniquement pour les ressources qu’elles utilisent, sans coûts fixes liés à l’achat ou à la maintenance de serveurs. Cette souplesse financière a contribué à son adoption massive : 82 % des entreprises déclarent utiliser au moins un service de cloud public en 2023 (Flexera 2023 State of the Cloud Report).
Le cloud public repose sur des infrastructures gérées par des fournisseurs comme AWS, Azure ou Google Cloud, offrant des bases de données performantes (MySQL, PostgreSQL) et des solutions de sauvegarde automatique intégrées.
Une flexibilité ajustable
Les entreprises adoptent le cloud public pour son mode de facturation à l’usage (Pay-as-you-go), qui permet d’ajuster les coûts en fonction de la consommation réelle. Cette souplesse s’accompagne d’une disponibilité élevée, souvent garantie par des SLA stricts fixés par les fournisseurs.
Par exemple : une application de e-commerce confrontée à des pics de trafic lors des soldes peut adapter dynamiquement ses ressources pour maintenir un SLO de haute disponibilité, tout en limitant les dépenses hors périodes de forte affluence.
Sécurité et surveillance continue
L’un des défis du cloud public concerne la gestion de la sécurité. Si les fournisseurs garantissent une redondance des données, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de détection d’intrusions et de surveillance en temps réel pour anticiper les menaces.
"La surveillance proactive et les sauvegardes régulières permettent d’assurer un haut niveau de résilience dans le cloud public." détaille Baptiste Benet, le cofondateur d’A1 Cloud
Ce modèle convient particulièrement aux organisations ayant des besoins fluctuants, comme les sites de commerce en ligne confrontés à des pics de trafic ponctuels, ou les entreprises technologiques qui développent des services numériques nécessitant une montée en charge rapide.
Une dépendance aux fournisseurs et des enjeux de sécurité
Toutefois, le cloud public présente aussi des limites. L’un des principaux enjeux concerne la maîtrise des données. En optant pour une infrastructure externalisée, les entreprises délèguent la gestion de leurs informations à des fournisseurs tiers, ce qui soulève des interrogations en matière de confidentialité et de conformité réglementaire.
La localisation des serveurs constitue également un point de vigilance. Certaines législations, comme le RGPD en Europe, imposent que les données des citoyens européens soient stockées dans des datacenters situés sur le territoire de l’UE. Or, tous les fournisseurs de cloud public ne garantissent pas cette conformité de manière transparente.
Un contrôle renforcé, mais des coûts plus élevés
Le cloud privé s’adresse aux entreprises qui nécessitent un niveau élevé de sécurité et de personnalisation. Contrairement au cloud public, où les ressources sont partagées entre plusieurs clients, le cloud privé repose sur une infrastructure dédiée, dont l’accès est strictement contrôlé.

Une gestion centralisée des données
Ce modèle est particulièrement adapté aux secteurs soumis à des réglementations strictes, comme la finance, la santé ou la défense. En maintenant les données sur des serveurs internes ou chez un prestataire spécialisé, les entreprises conservent un contrôle total sur leur gestion et leur sécurisation.
Cette maîtrise permet également une personnalisation avancée de l’environnement informatique. Les configurations peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de l’entreprise, contrairement aux offres standardisées du cloud public.
Un investissement plus lourd et une évolution limitée
Toutefois, ces avantages ont un coût. Contrairement au modèle Pay-as-you-go du cloud public, le cloud privé nécessite un investissement initial important en matériel et en personnel qualifié pour assurer la maintenance et la sécurité des infrastructures.
De plus, il offre une évolutivité moindre. Si une entreprise doit augmenter temporairement sa capacité de calcul, elle devra soit investir dans de nouveaux serveurs, soit supporter une surcharge temporaire de son infrastructure existante. Cette rigidité peut s’avérer contraignante face aux besoins de flexibilité croissants.
Un plan de reprise après sinistre optimisé
Les entreprises ayant recours au cloud privé peuvent définir un plan de reprise après sinistre (PRA) adapté à leurs besoins. La mise en place de sauvegardes régulières et de redondance des données assure une récupération rapide en cas d’incident.
Exemple : une entreprise du secteur de la santé stockant des données sensibles sur un cloud privé peut garantir leur intégrité grâce à des mécanismes avancés de sauvegarde et réplication.
"Les SLA définis sur un cloud privé sont souvent plus exigeants, ce qui garantit un haut niveau de disponibilité et de réactivité en cas de panne." rappelle Baptiste Benet
Une solution intermédiaire adaptée aux besoins complexes
Le cloud hybride combine les atouts du cloud public et du cloud privé. Il permet aux entreprises de gérer stratégiquement leurs ressources, en allouant les charges de travail selon leur criticité et leurs exigences de sécurité.

Une gestion optimisée des ressources
L’un des principaux avantages du cloud hybride est sa capacité à combiner sécurité et flexibilité. Les entreprises peuvent stocker leurs données sensibles sur un cloud privé, tout en profitant de la puissance du cloud public pour exécuter des applications nécessitant des ressources évolutives.
"Le cloud hybride permet d’avoir le meilleur des deux mondes : la sécurité et la gouvernance du cloud privé, combinées à la scalabilité du cloud public." analyse Baptiste d’A1 Cloud
Ce modèle convient particulièrement aux grandes entreprises qui doivent jongler entre des impératifs réglementaires et des besoins technologiques évolutifs.
Une complexité accrue dans la gestion des infrastructures
En revanche, la mise en place d’un cloud hybride implique une orchestration avancée. Il faut assurer l’interopérabilité entre les différents systèmes, garantir la sécurité des échanges de données et optimiser la gestion des coûts entre les deux environnements.
Des solutions comme AWS Outposts ou Google Anthos permettent d’intégrer plus facilement les infrastructures hybrides, mais elles nécessitent une expertise technique poussée. Une étude réalisée par Flexera a constaté que 87 % des organisations utilisent une stratégie multi-cloud, tandis que 72 % utilisent une approche hybride.
Et par ailleurs, selon le dernier rapport Gartner, d'ici 2027, 90 % des organisations adopteront une approche hybride dans leur infrastructure cloud.
Par exemple, une entreprise industrielle souhaitant maintenir des données critiques sur un cloud privé tout en exploitant le cloud public pour des simulations IoT doit garantir une redondance des données et une synchronisation optimale entre les plateformes.
Comment choisir la meilleure approche ?
Le choix entre cloud public, privé et hybride dépend de plusieurs facteurs, résumé ci-dessous sous forme de tableau :
Critères |
Cloud Public |
Cloud Privé |
Cloud Hybride |
Coût |
Ajustable (Pay-as-you-go) |
Investissement initial élevé |
Modèle mixte et optimisé |
Scalabilité |
Élastique et immédiate |
Limité aux ressources internes |
Évolutif avec gestion optimisée |
Sécurité |
Gérée par le fournisseur |
Contrôle total par l’entreprise |
Sécurisation des données sensibles |
Conformité |
Dépend des engagements SLA |
Adapté aux exigences strictes |
Meilleure répartition des charges |
Les start-ups technologiques privilégient souvent le cloud public pour sa scalabilité, tandis que les grandes entreprises du secteur financier s’orientent vers un cloud privé garantissant un contrôle total des SLA et des données. Le cloud hybride, quant à lui, répond aux besoins des organisations souhaitant concilier performance, conformité et flexibilité.
Il s’agit d’une question stratégique, influencée par des facteurs techniques et économiques. La nécessité d’une sauvegarde automatique, la gestion d’un plan de reprise après sinistre, ou encore la garantie d’un SLO élevé sont autant de paramètres qui orientent le choix des entreprises.
Dans un contexte où la surveillance en temps réel et la détection d’intrusions deviennent des standards, la gestion du cloud computing repose sur une analyse approfondie des besoins spécifiques à chaque organisation.
Pour les entreprises en forte croissance ou en quête d’innovation, le cloud public représente souvent la meilleure option. À l’inverse, les organisations nécessitant un contrôle strict des données s'orientent vers un cloud privé. Enfin, le cloud hybride s’impose comme une alternative efficace pour conjuguer sécurité et évolutivité.